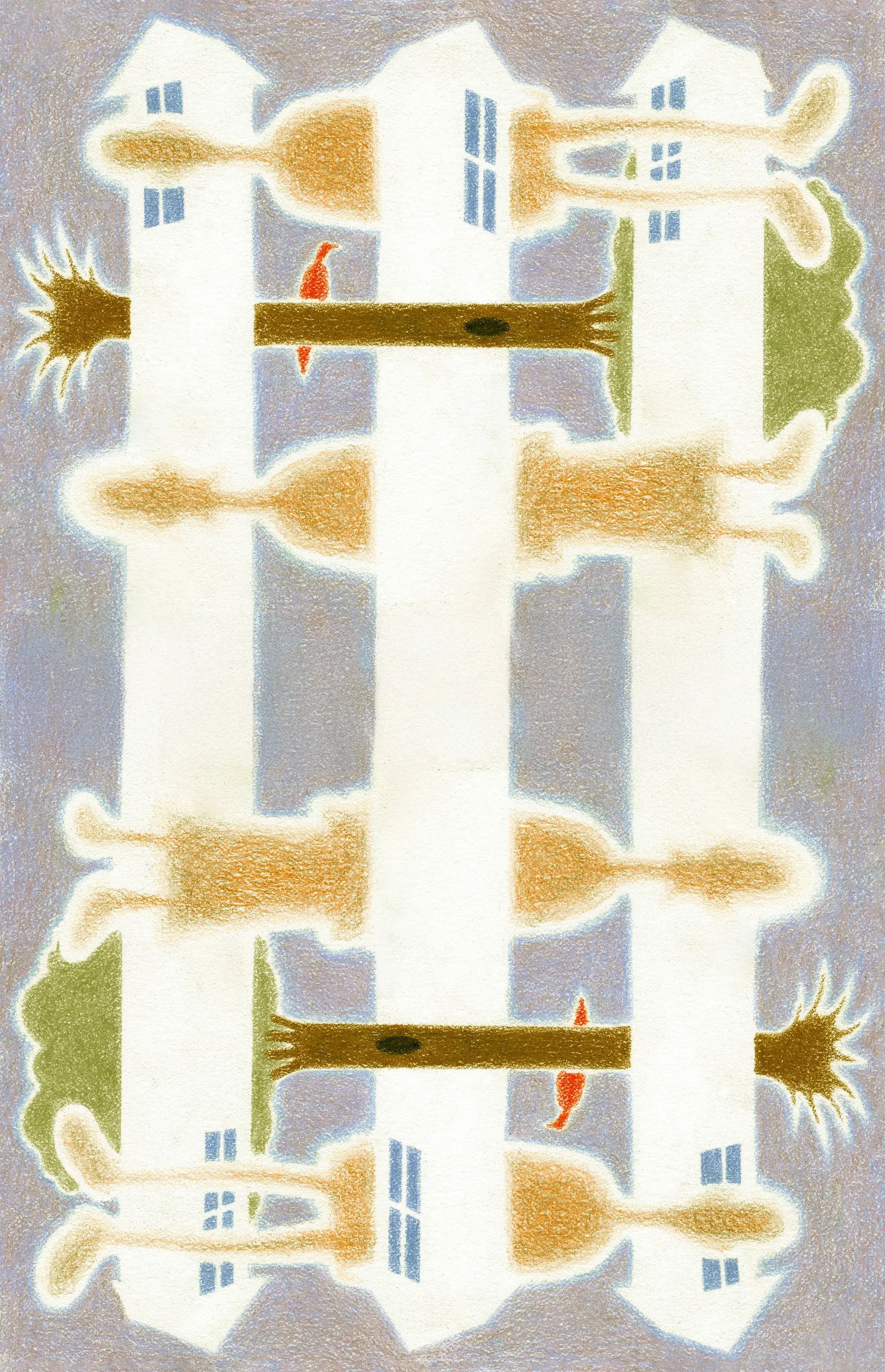
January 30, 2026
Photo
Mathieu Larone
January 30, 2026
Photo
Mathieu Larone
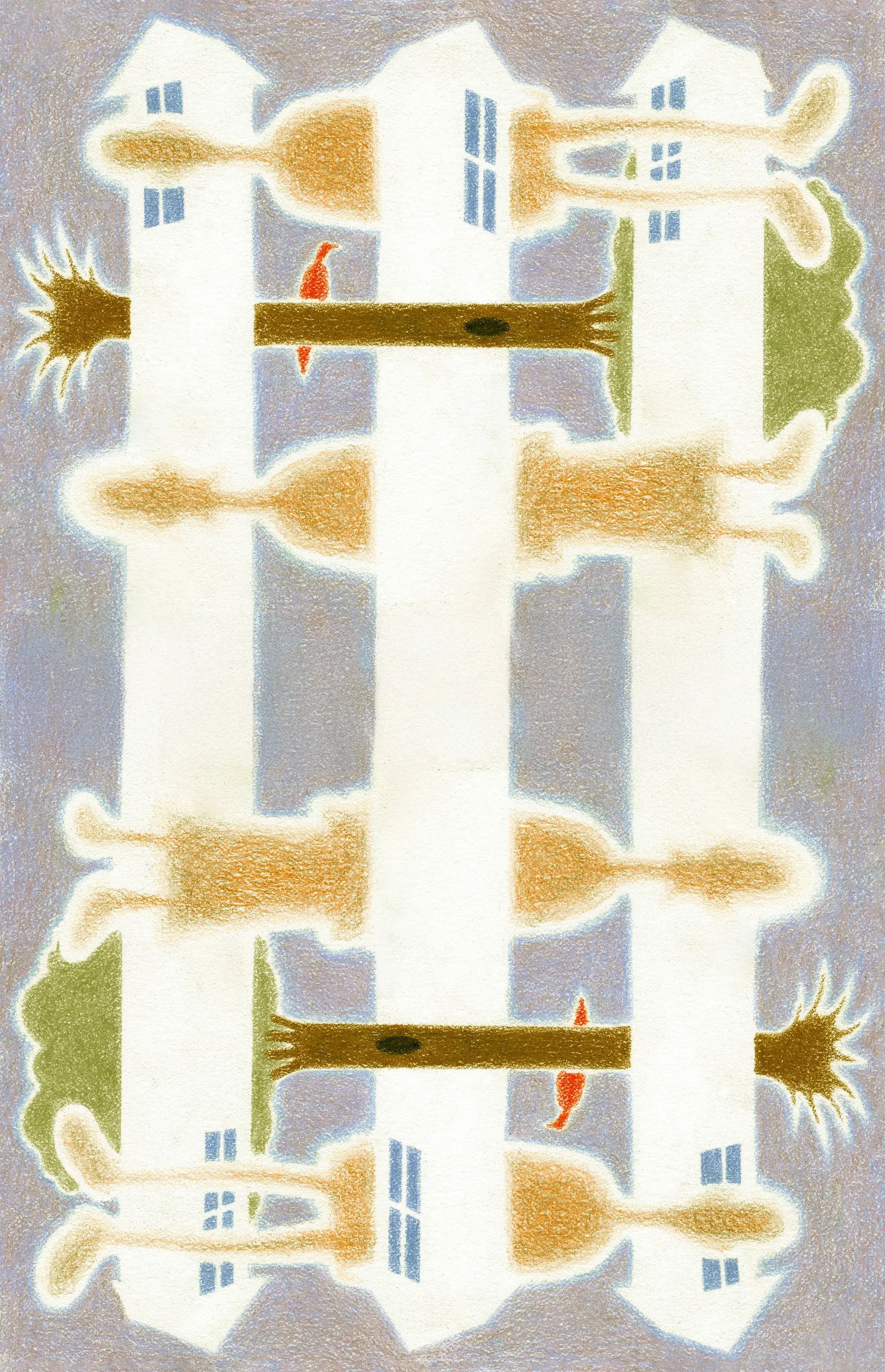
«Les personnes qui font confiance à leurs voisin·e·s affichent un plus haut taux de satisfaction à l’égard de la vie»—c’est ce qu’on peut lire dans une infographie produite par Statistique Canada diffusée en 2023. À elle seule, cette statistique permet d’offrir un regard sur un problème qui inquiète de plus en plus les autorités en santé publique―ce qu’on appelle «l’épidémie de solitude»―, mais aussi sur son remède.
Au Canada, 13,4% de la population déclarait, fin 2024, se sentir «toujours ou souvent seul·e». Au Québec, en 2023, c’étaient 28% des gens qui affirmaient ressentir un sentiment d’isolement «parfois ou souvent». Derrière tous ces nombres, la réalité est préoccupante: nous nous sentons de plus en plus souvent isolé·e·s. Les conséquences de cette solitude sont bien réelles, allant de la dépression aux maladies chroniques, en passant par les dépendances à l’alcool ou aux jeux d’argent. On la compare souvent au tabac. Une petite puff d’isolement, quelqu’un?
Qui—ou quoi—blâmer? L’internet et les réseaux sociaux ont le dos large—ils semblent responsables de tous les maux de notre société. Mais dans une étude menée pour le compte de l’American Psychological Association en 2024, on pointe aussi «les normes culturelles aux États-Unis [qui] sont souvent caractérisées par l’individualisme [...], le déclin des liens sociaux et la polarisation politique croissante».
À cela, arguent plusieurs sociologues, doit s’ajouter un facteur trop souvent négligé: l’aménagement de nos villes.
Assise dans une voiture à l’heure de pointe, je deviens misanthrope. Enfermée dans ma boite de métal, stressée par la vitesse et les décisions rapides que la puissance de l’engin demande, je m’exaspère de chaque erreur de mes comparses de route. Une fois stationnée, je respire enfin de nouveau. Et malgré mes années d’expérience, je m’étonne toujours de me découvrir si hargneuse.
À l’opposé, difficile pour moi de me souvenir d’un moment où une promenade aurait provoqué ce type d’émotion. Les marches que je fais dans le quartier où j’habite depuis 20 ans m’émerveillent encore régulièrement.
Lors de mes pérégrinations, je veille à ce que les marches de la voisine âgée aient bien été déneigées, que les livres dans la bibliothèque de quartier soient bien rangés, je salue la voisine et sa fille qui rentrent de l’école à pied. Bien loin de ma rancœur envers les humains, je tisse des liens tout doux. Cette expérience ne m’est pas unique. De fait, les études s’empilent pour confirmer que notre bienêtre collectif repose en grande partie sur ces moments de rencontre passagers. Pourtant, depuis les années 1950, nos efforts d’aménagement ont surtout visé à nous éloigner les un·e·s des autres. Nos autoroutes se sont élargies, nos maisons ont grossi, nos voitures aussi. C’est le rêve américain: celui où chaque famille nucléaire a sa maison à elle et son gazon à entretenir.
«Avec la suburbanisation, on a privatisé des espaces autrefois collectifs», explique Guillaume Éthier, professeur au Département d’études urbaines de l’UQAM.
Résultat: les piscines publiques se vident, les cinémas de quartier ferment et chacun·e reste chez soi, sans parler à personne.
Avec tout ça, nous nous distançons de ces espaces essentiels et, avec eux, de la possibilité de rencontres fortuites. Dans le cadre d’une étude sur l’impact des rues piétonnes, Guillaume Éthier a mesuré la proportion de gens qui y ont croisé des inconnu·e·s auparavant. Près de 15% des répondant·e·s y ont non seulement fait des rencontres, mais ont carrément entretenu ce lien tout neuf au point de devenir ami·e·s. La preuve, bref, qu’avec ces frottements quotidiens on peut agrandir notre réseau social.
Mauvaise nouvelle: «Les villes se transforment lentement», remarque Karl Dorais Kinkaid, urbaniste à la coopérative de travail Enclume. «Même si les gens demandent plus d’espaces publics, ils ne vont pas apparaitre du jour au lendemain.» En effet, il peut en effet se passer de nombreuses années entre le moment où la volonté citoyenne s’exprime et celui où un projet est finalement inauguré. Sans compter que le manque à gagner est énorme: «On part avec un déficit de plus de 50 ans!»
Les solutions devront être imaginatives et flexibles. Pour Guillaume Éthier, le placemaking—qui inclut des initiatives comme les ruelles vertes ou les activités culturelles organisées sur des rues piétonnes—correspond à cet «urbanisme souple» qu’il préconise.
Urbaniste pour la firme Ædifica, Mathilde Falgueyret considère l’art public comme un puissant vecteur du tissu social. «La culture nourrit l’espace urbain», tranche-t-elle. En plus de créer une culture commune et un sentiment d’appartenance, l’art, par sa simple présence, peut transformer l’ambiance d’un lieu, le rendant digne d’une flânerie.
Si l’urbanisme contribue à nous isoler, il ne faut cependant pas croire que des espaces publics parfaitement conçus sauraient suffire à résoudre nos problèmes. «Offrir des espaces publics ne suffit pas à susciter le désir de s’y rendre, rappelle Guillaume Éthier. Il faut qu’on ait envie de tisser des liens et de bâtir des communautés.»
Lutter contre la solitude, bref, c’est aussi construire un avenir plus collectif. Face à la montée de l’autoritarisme, la création de communautés solidaires devient un rempart essentiel. Ces liens sociaux prennent tout leur sens quand vient le temps de traverser les tempêtes, mais ils jouent aussi un rôle fondamental dans la résistance collective. Et pour avancer, ensemble.














