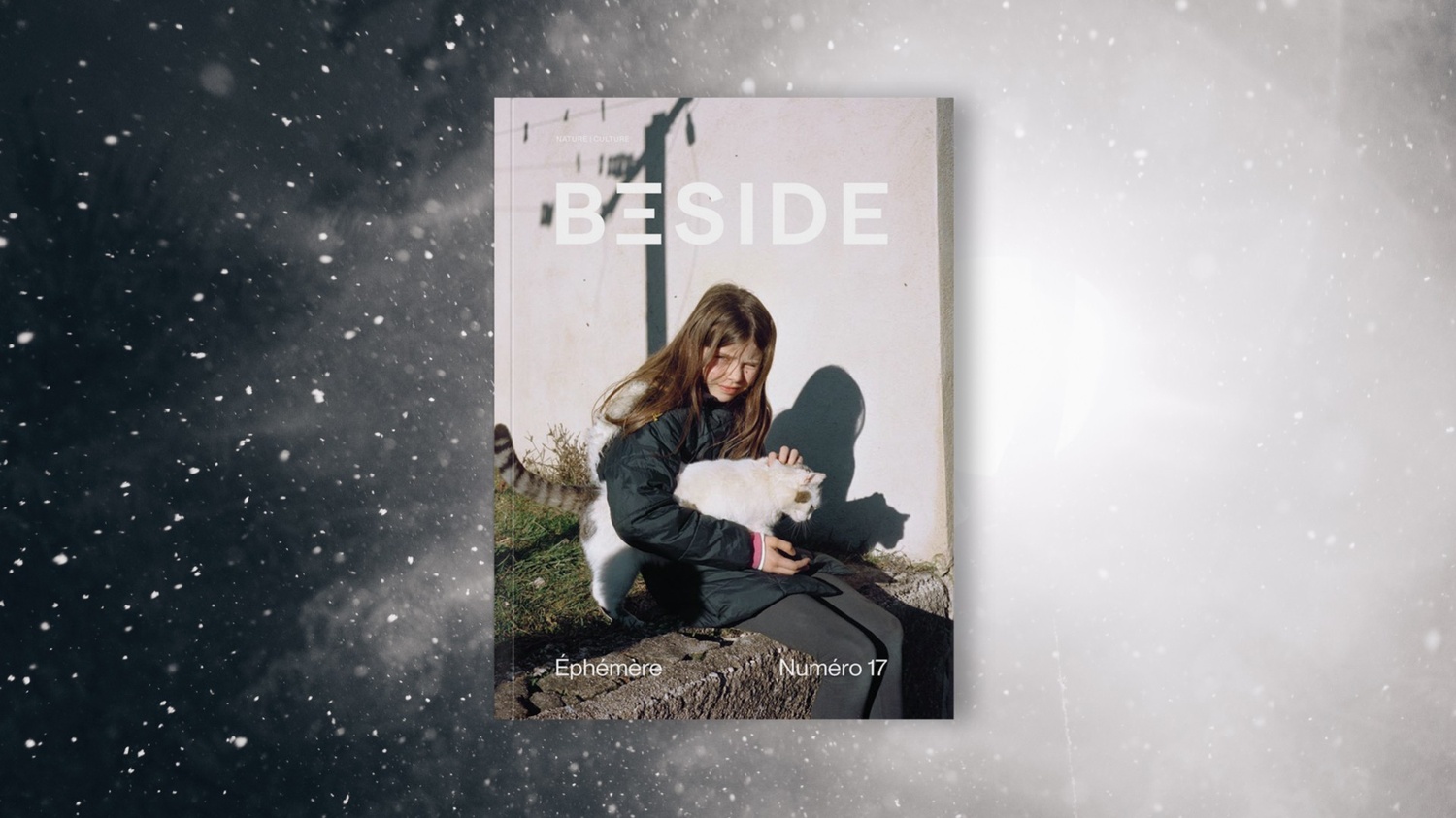February 24, 2024
Photo
Maxime Prévost
February 24, 2024
Photo
Maxime Prévost

Pour Ariane Paré-Le Gal, le sirop de bouleau est un incontournable du garde-manger depuis l’adolescence. Son père, Gérald Le Gal, retournait chaque printemps dans son Manitoba natal pour entailler des bouleaux avec son frère. Ensemble, ils faisaient bouillir la sève jusqu’à l’obtention d’un délicieux sirop qu’ils partageaient ensuite avec leurs proches.
En 1993, Gérald a fondé Gourmet Sauvage, une entreprise qui vise à rapprocher les gens de la nature grâce à des produits récoltés de façon durable au Québec. Au départ, on n’en proposait que quatre, puis l’offre s’est élargie. Le sirop de bouleau s’y est rapidement taillé une place.
L’entreprise, qui appartient désormais à Ariane Paré-Le Gal et à son conjoint, Pascal Benaksas-Couture, vend du sirop de bouleau partout au Canada. Et Ariane s’assure de transmettre son amour du produit à ses enfants, comme son père l’a fait avec elle.
Bien qu’il ait tout à fait sa place dans les plats sucrés, le sirop de bouleau — dont le gout rappelle celui d’une réduction de vinaigre balsamique — se prête mieux aux recettes salées. Ariane adore le servir avec de l’huile d’olive et du pain frais, «quelque chose de simple, mais de tellement délicieux».
Peu d’entre nous ont gouté aux sirops préparés avec la sève de bouleau, de hêtre, de noyer ou d’autres essences. Cependant, l’intérêt grandissant pour ces sirops alternatifs et leur apport à la gastronomie et à la protection des forêts pourraient bien changer la donne.
Pour le retour de la biodiversité dans les érablières
Comme le sirop d’érable, les sirops alternatifs sont ce qu’on appelle des produits forestiers non ligneux. La sève est créée naturellement et sa récolte ne nécessite pas d’abattage, ce qui permet aux producteur·rice·s de subvenir à leurs besoins sans nuire aux forêts. L’industrie des sirops alternatifs permet également de redonner de la valeur aux arbres qui ont été durement affectés par les ravageurs et les maladies, comme le hêtre à grandes feuilles.
Au Canada, la production de sirop d’érable a plus que doublé au cours des 15 dernières années. Mais cette croissance vient avec une tendance à privilégier les érables au détriment d’autres espèces dans les érablières.
Steve dirige le projet Bird-Friendly Maple Project à Audubon, au Vermont. L’initiative vise à améliorer les habitats des oiseaux en forêt en valorisant le travail des producteur·rice·s de sirop d’érable qui diversifient leur érablière.
Lorsque les érables représentent plus de 90 % de la superficie, on parle d’une véritable monoculture. La forêt devient alors plus vulnérable aux ravageurs, aux maladies, aux changements climatiques, notamment, et sa capacité à soutenir la faune est limitée.
«La croissance de l’industrie de l’érable pourrait exercer une pression de plus en plus grande sur les monocultures», croit Steve.
De nouveaux horizons pour la production de sirop
Les sirops alternatifs incitent les producteur·rice·s à entretenir des arbres qui ne sont pas des érables, et à tirer parti de ces essences grâce à l’équipement déjà sur place. Heureusement, la saison des sucres des autres arbres n’entre pas en conflit avec celle de l’érable, qui dure de la fin de l’hiver jusqu’au début du printemps. La saison du bouleau, par exemple, commence à la fin du printemps.
«De plus en plus de gens de l’industrie s’intéressent au sirop de bouleau parce qu’ils ont les outils, les installations et l’équipement nécessaires pour continuer la saison après les sucres», explique Ariane Paré-Le Gal.
Mais l’exploitation d’autres essences entraine quelques défis. La teneur élevée en eau de la sève de bouleau et de hêtre demande beaucoup plus de travail que la sève d’érable. S’il faut environ 40 litres de sève d’érable pour produire un litre de sirop, il faut plus de 100 litres de sève de bouleau et de hêtre pour obtenir le même volume.
Le rythme de travail constitue un autre enjeu. Pour beaucoup de petites productions, le temps des sucres représente de longues journées de 15 heures. Le nettoyage de l’équipement pour tout recommencer après des mois de dur labeur, la fatigue et l’envie de passer à autre chose peuvent être des facteurs dissuasifs.
Le travail supplémentaire des producteur·rice·s qui persévèrent est toutefois récompensé par des prix de détail plus élevés, des productions uniques et des forêts que la diversité rend plus saines et plus résilientes.
«Comme les gens continuent de chercher des produits locaux et durables, ils sont plus susceptibles de se tourner vers les sirops alternatifs», croit Adam Wild, directeur du centre de recherche Uihlein Maple Research Forest de l’Université Cornell et producteur de sirop de bouleau.
Les sirops alternatifs n’obtiendront jamais la même popularité que le sirop d’érable, profondément ancré dans une tradition et des siècles de récolte et de production finement élaborées. Ils sont cependant appelés à se faire une place sur les tablettes à mesure que le public découvre leurs bienfaits sur les plans environnemental et gastronomique.

Le bouleau est exploité depuis des centaines d’années dans le nord de l’Europe, où l’on fait usage de sa sève pour préparer des tisanes et des thés toniques du printemps. Pendant longtemps, les producteur·rice·s n’avaient pas l’équipement spécialisé nécessaire pour transformer en sirop de grandes quantités de sève de bouleau en raison de sa teneur élevée en eau. La technique de l’osmose inversée, qui permet de retirer environ 90 % de l’eau de la sève avant l’ébullition, a contribué à élargir la production.
Le sirop de bouleau est le plus souvent fabriqué à partir de bouleau blanc ou jaune, et les deux essences sont parfois utilisées dans un même sirop. Le sirop de bouleau de Gourmet Sauvage provient de bouleaux blancs, tandis que celui de l’Érablière Escuminac est fabriqué à partir de bouleaux jaunes.
Notes de dégustation: Le gout peut varier selon la période où la sève a été recueillie — les premières coulées de la saison sont parfois plus sucrées que les suivantes —, mais le sirop de bouleau a généralement un gout de mélasse, d’anis et de café, avec une pointe d’acidité rappelant le vinaigre balsamique. Le sirop de bouleau jaune a tendance à présenter des notes plus florales et acides que le sirop de bouleau blanc.
À essayer: Le sirop de bouleau est un excellent complément aux marinades de viande et de tofu; on peut aussi en ajouter un filet sur les plateaux de charcuteries, les salades, les quiches, les pizzas et les pétoncles.
Où en trouver: Le sirop de bouleau est produit principalement dans le centre du Canada, en Alaska et dans le nord-est des États-Unis.

La maladie corticale du hêtre a grandement nui à la profitabilité du hêtre à grandes feuilles. Elle se développe lorsque les spores des champignons prolifèrent dans les blessures du tronc causées par la cochenille. Peu à peu, le tronc se couvre de corps fongiques et de chancres, qui empêchent la circulation d’eau et de nutriments entre les racines de l’arbre et le houppier. Comme asphyxié, le hêtre s’affaiblit progressivement et finit par tomber au moindre vent fort. Mais le système racinaire, lui, ne meurt pas et continue de produire de jeunes arbres, qui connaitront le même sort.
L’entaillage de jeunes hêtres permet d’en tirer profit avant leur chute. Et il ne faut pas s’inquiéter: les cochenilles, champignons et autres êtres nuisibles ne contaminent pas le produit final.
La production de sirop de hêtre est encore récente et sa mise en marché demeure limitée. La récolte de la sève est un peu plus complexe que pour l’érable ou le bouleau, car elle ne coule pas d’elle-même et doit être recueillie par un système de pompe à aspiration.
Notes de dégustation: Le sirop de hêtre présente des notes de prunes séchées, de raisins secs et de poires, avec une finale aux accents de noisette.
À essayer: Le sirop de hêtre possède une saveur sucrée intense qui se prête bien aux recettes dans lesquelles on retrouve habituellement du sirop d’érable ou de la mélasse, comme le pain d’épices ou la tarte aux pacanes.
Où en trouver: Le sirop de hêtre est produit le plus souvent dans le nord-est des États-Unis. L’entreprise Forest Farmers a été l’une des premières à le commercialiser.

Le noyer noir est apprécié comme bois d’œuvre et pour les noix qu’il produit, mais on l’utilise peu pour produire du sirop. Contrairement à la sève de bouleau et de hêtre, qui contient beaucoup d’eau, la teneur en sucre de la sève de noyer est semblable à celle de l’érable. Cependant, la sève de noyer n’est pas aussi abondante: il faut environ sept fois plus de noyers que d’érables pour produire la même quantité de sirop. Par conséquent, la production commerciale de sirop de noyer noir pur est limitée, et, bien souvent, c’est un mélange de sirop de noyer et de sirop d’érable que l’on trouve sur le marché.
Notes de dégustation: Le gout du sirop de noyer est semblable à celui du sirop d’érable, avec des accents de caramel et de noix.
À essayer: Le gout caramélisé du sirop de noyer se prête bien aux boissons et aux plats sucrés. Essayez-le avec des crêpes, des gaufres ou de la crème glacée à la vanille, ou ajoutez-en à un verre de bourbon, à un cocktail ou à un extrait naturel de plante (teinture).
Où en trouver: Le noyer noir est répandu dans l’est de l’Amérique du Nord, mais la production de sirop est plus courante dans les Appalaches, aux États-Unis, où le noyer pousse en abondance.
De nombreuses essences font l’objet d’expérimentations. Le platane d’Amérique, l’ostryer de Virginie, le tilleul d’Amérique et l’aulne font de bons arbres à sirop grâce à leur profil de gout unique et à leur teneur en sucre. Il faudra peut-être attendre un peu avant que ces variétés soient plus accessibles, mais vous pourriez en dénicher dans des boutiques spécialisées ou des marchés fermiers.
***
Souvent produits en petites quantités, les sirops alternatifs peuvent être difficiles à trouver et coutent habituellement plus cher que le classique sirop d’érable. Ils constituent cependant une excellente façon de soutenir des forêts saines et diversifiées, de gouter à des saveurs délicates et d’essayer de nouvelles recettes.
«Le fait de rapprocher les gens de leur environnement naturel et sauvage grâce aux produits forestiers leur permet d’en apprendre plus sur le monde qui les entoure, et de l’aimer et de le protéger, croit Ariane Paré-Le Gal. Lorsqu’ils goutent à du sirop de bouleau, à des câpres de baies de sureau ou à des cœurs de quenouilles, ils prennent conscience de ce que la nature nous offre depuis des milliers d’années.»